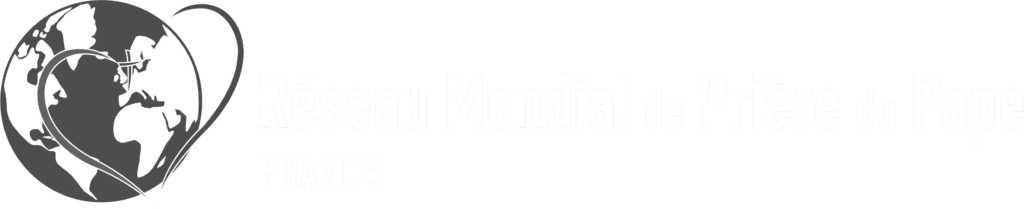Éclairage historique sur les avancées du dialogue interreligieux
octobre 2025
Après le Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate de 1965 (1) où les autres religions « reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » un autre événement fondateur s’est tenu, en octobre 1986 : la Journée mondiale de Prière interreligieuse pour la paix convoquée par le pape Jean-Paul II, à Assise. Il s’agissait d’« être ensemble pour prier », même s’il n’était pas possible de prononcer une prière commune.

En effet, l’Église met en garde contre le risque de syncrétisme ou la tentation d’aplanir les différences qui ne peut conduire qu’à un appauvrissement des convictions de chacun. Deux mois après cette première rencontre d’Assise, Jean-Paul II a parlé, devant la curie romaine, du « mystère d’unité » et de la « prière authentique suscitée par l’Esprit Saint, mystérieusement présent dans le cœur de tout homme ».
Chaque forme de prière permet une démarche d’accueil de l’autre et d’hospitalité, les différences étant reconnues comme une richesse. C’est sur cette conviction que se fonde le dialogue interreligieux. C’est ensemble que nous pouvons cheminer vers un Absolu qui nous dépasse, « dans une véritable émulation de sainteté », comme l’écrivait le père Jules Monchanin (2) .
Le dialogue interreligieux peut se vivre de différentes manières. Le document Dialogue et Annonce, publié en 1991 par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l’évangélisation des peuples parle des quatre formes du dialogue interreligieux, sans établir de hiérarchie entre elles :
- le dialogue de la vie, celui du bon voisinage et de la convivialité
- le dialogue des œuvres celui de la collaboration pour plus de justice
- le dialogue des échanges théologiques, celui des spécialistes travaillant sur leurs héritages religieux respectifs
- le dialogue de l’expérience religieuse, où des personnes enracinées dans leurs propres traditions religieuses partagent leurs richesses spirituelles, par exemple par rapport à la prière et aux voies de la recherche de Dieu ou de l’Absolu ».
C’est ainsi que les premières rencontres interreligieuses furent celles de moines au sein du Dialogue Interreligieux Monastique (D.I.M.). Le trappiste Thomas Merton participa au premier colloque en 1968 à Bangkok. Lui-même a vécu le dialogue de l’amitié avec des spirituels de différentes traditions religieuses, s’enrichissant de leurs expériences parfois très différentes, mais dans lesquelles on pouvait reconnaître l’Esprit à l’œuvre.
En février 2019, à Abou Dhabi, l’imam d’Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, et le pape François ont ensemble signé le « document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune ». Ce fut un signal fort de dialogue entre les deux plus grandes religions du monde. On peut aussi mentionner l’odyssée du Bel Espoir, ce bateau où embarquent des jeunes de tous les pays du pourtour méditerranéen et de toute religion, réunis pour construire la paix au-delà des frontières et qui fera escale le 25 octobre à Marseille.
Agnès Gros, association Chemins de Dialogue, Marseille
(1) Nostra aetate est une déclaration du concile Vatican II sur les relations de l’Église catholique avec les religions non chrétiennes.
(2) Jules Monchanin était un prêtre catholique français du début du XXème siècle, moine et ermite, ardent promoteur de l’inculturation de la vie religieuse chrétienne en Inde et du dialogue interreligieux hindou-chrétien.